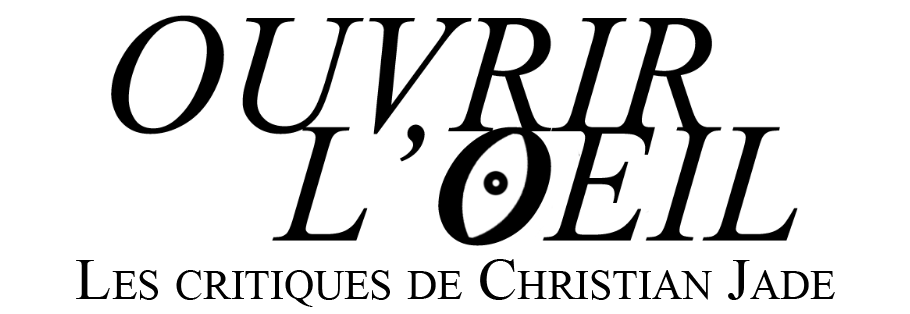PARSIFAL (Wagner) : un flot d’images vidéo encombre un flux de voix superbes dont un Parsifal transcendant.
Il fut un temps à l’Opéra des Flandres, le Parsifal de Wagner était donné régulièrement à Pâques puisque ce drame sacré peuplé de chevaliers du Saint Graal illustre « l’enchantement du vendredi saint ». L’avant-dernière version vue en 2019, due à Tatjana Gürbaca, estompait le message guerrier, chrétien, masculiniste et rendait possible, moyennant quelques tours d de passe-passe, l’amour entre Kundry et Amfortas en refusant le « péché » lié au sexe. Ici, la mise en scène du duo Susanne Kennedy/Markus Selg revient au mysticisme d’origine mais avec un œil contemporain, à base d’une profusion d’images générées artificiellement , techniquement bluffant.
Susanne Kennedy et son scénographe vidéaste Markus Selg font depuis une dizaine d’années les beaux jours des grands festivals de théâtre, des Wiener Festwochen au Festival d’Automne à Paris, en passant par le Kunstenfestivaldesarts (KFDA) de Bruxelles. Il y a deux ans on les découvrait au KFDA dans Angela (a strange loop) où la vie d’une femme importait moins que les procédés techniques permettant de décaler le réel et le virtuel. Moyennement convaincant.
Après le « post-modernisme » voici donc le « post-humanisme », où le personnage et l’être humain deviennent des objets ouvertement manipulés. En phase avec les jeux vidéo (parfois plus réels que le réel) et la réalité «objective » niée par certains politiques.
Au théâtre soumettre un texte à la vision du metteur en scène est monnaie courante. A l’opéra la musique fait de la résistance. Pour le duo Kennedy/Selg, commencer il y a un an par le monde répétitif, performatif et rêvé de Phil Glass et Bob Wilson, dans Einstein on the beach était une bonne entrée en matière.
Le Parsifal de Wagner est plus résistant sur le fond et la forme. Sa dernière œuvre, pétrie du mysticisme chrétien médiéval des chevaliers du Graal, contredit sa vision païenne du Ring et de son Crépuscule des dieux. Son ami Nietzche, la païen adorateur des Grecs, lui reprocha et son éloge du christianisme et sa condamnation implicite de la sexualité via le personnage de Kundry. Elle est coupable d’avoir séduit et Amfortas, le roi des chevaliers, blessé à jamais et le jeune Parsifal, un innocent au cœur pur dont la chasteté le destine à restaurer l’ordre du Graal, protecteur du sang du Christ.
Cette restauration symbolique de l’ordre des chevaliers chrétiens germaniques devait nourrir des décennies de nationalisme allemand conquérant puis du nazisme faisant de Wagner leur « guerrier antisémite ». Après 1945, la musique de Wagner en général et Parsifal en particulier furent traités avec beaucoup de précaution.



Parsifal, le Christ et Bouddha
La mise en scène de Susanne Kennedy et de son vidéaste Markus Selg coïncide avec le mysticisme wagnérien nourri d’un soupçon de philosophie orientale rapprochant Parsifal, le Christ et Bouddha.
La scène est délimitée par un immense heptagone (ah le chiffre 7 dans les religions !) laissant filer sur ses côtés des mouvements d’images, générées par un vrai « moteur à images » lui aussi de forme heptagonale au cœur de la scène. L’immense et sublime prologue initial est envahi par un mouvement lumineux abstrait auquel succède le paysage pyrénéen de Montsalvat, nid d’aigles des chevaliers puis les entrailles de la terre où ils se sont réfugiés.
C’est très beau ce « cœur mystique » coloré, crachant le feu, suggérant le sang et laissant échapper de sombres nuages ou des abstractions colorées ou lumineuses. Beau mais agressif, monotone à force de répétitions envahissantes qui empêchent notre concentration sur l’essentiel : la sublime musique de Wagner. On retrouvera ces climats mystico-dynamiques au 3e acte pour le retour de Parsifal, couronné Roi de ces chevaliers, avec un oubli majeur : la beauté de la nature, éclipsée. Au début du 2e acte, en principe érotique et dynamique, on entend enfin la musique car le moteur à images se calme. Mais le contraste est trop grand : les femmes fleurs, censées séduire Parsifal sont immobiles, en robes blanches désincarnées, comme un chœur de nonnettes. Kundry la séductrice, petite fille à tresses en robe blanche, tenue à distance, immobile, statufiée peut tout juste donner le fameux baiser tentateur au jeune innocent.
Le maléfique Klingsor, en jupette tristounette (le malheureux s’est châtré pour mériter d’être un chevalier asexué) n’a rien d’un magicien. L’acte 2 est donc volontairement désincarné et on songe au Mallarmé de « Brise marine » : La chair est triste, hélas, et j’ai lu tous les livres .
Reste un être lumineux, vêtu de blanc éclatant, Parsifal, qui a droit au mouvement, à la relative nudité, bref à l’incarnation, présent sur scène du premier au dernier acte parfois vu de dos, confiné dans le fameux heptagone mystique central. Il est incarné par un ténor américain exceptionnel Christopher Sokolowski, qui a appris ce rôle écrasant en 3 semaines, suite à un désistement, et dont la prestance physique et vocale sont la « divine surprise » de cette production, musicalement remarquable. La mezzo-soprano allemande Dshamilja Kaizer a dans la voix les couleurs et les intensités dramatiques que la mise en scène ne lui permet pas de vivre en mouvement. Dans ce paradis des voix graves l’Amfortas du baryton Kartal Karagedik séduit par son timbre profond et son énergie chaleureuse. Werner Van Mechelen en Klingsor et, en Gurnemanz, l’inusable Albert Dohmen, wagnérien de référence à 70 ans, sont de grands interprètes solides aux voix immenses.
Enfin la direction d’Alejo Pérez permet à l’orchestre maison de briller dans un Wagner de 4 heures d’une intensité dramatique soutenue.
En somme un duo de vedettes du théâtre contemporain, Susanne Kennedy et Markus Selg dont le « post-humanisme » nous a moyennement convaincu malgré sa virtuosité colorée. Et une très belle distribution avec la révélation du ténor américain Christopher Sokolowski.
Christian Jade
Jusqu’au 22 octobre à l’Opéra des Flandres, Anvers. www.operaballet.be
Copyright (c)Photos : OBV/Annemie Augustijns.