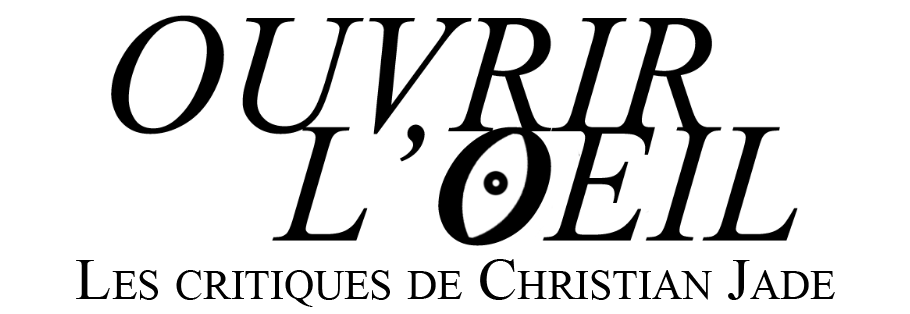« MADAME BUTTERFLY » DE PUCCINI. Andrea Breth à la mise en scène et Ermonela Jaho en Cio-Cio-San jouent sur une intense sobriété.
C’est un classique des classiques, beau, stylisé, respectueux de l’art japonais que nous propose Andrea Breth à la surprise générale de ceux qui la connaissent décapante et révolutionnaire des formes. À la Monnaie de Bruxelles, en mai dernier, son interprétation surréaliste et « hard » du Turn of the screw de Britten collait parfaitement avec l’inquiétante étrangeté de la nouvelle de Henry James. Ici la mise en place d’un univers poétique japonais éloigne le mélodrame de son pathos originel pour intérioriser et ritualiser la douleur.
Le suicide d’une adolescente de 15 ans, Cio-Cio-San alias Butterfly, bernée par un officier américain et « rachetée » par un prince japonais pourrait faire l’objet d’une mise en scène hyperréaliste surlignant le rôle infâme du colonialisme américain et le conservatisme du patriarcat asiatique. Le tout sur fond de panneaux féministes et de polémiques vengeresses sur les réseaux sociaux pour dénoncer l’amant américain Pinkerton volage, lâche et cynique ainsi que les traditions japonaises patriarcales qui la condamnent à l’enfermement.
C’est une option mais ce n’est pas le genre de la metteuse en scène, Andrea Breth qui estime cette histoire cynique suffisamment connue et tente donc d’intérioriser le contenu dramatique par la forme. Les structures mobiles de décor japonais raffiné jouent du début à la fin sur l’enfermement de la jeune héroïne dans un univers confiné. Butterfly est coincée, quoi qu’elle fasse et le reniement de sa religion et de sa famille n’y changera rien. Les menaces viennent de l’intérieur même de son propre univers auquel elle tente en vain d’échapper. Elles sont incarnées par un groupe étrange de masques blancs sortis tout droit du théâtre kabuki comme autant de signes implicites du destin final. Pas l’ombre d’une échappée lumineuse comme ce fameux port de Nagasaki où elle guette en vain depuis trois ans le retour de son « mari ». La seule lumière vient d’un vol de grues manipulées lentement dans le noir par des marionnettistes qui envahiront le plateau (au finale) comme autant de vaines espérances. Le décor d’estampe japonaise permet aussi de mieux ressentir les interventions de la famille, de l’entremetteur et du bonze pour récupérer la « brebis égarée », entêtée à attendre son mari américain. .
Enfin, dans ce mélodrame dépourvu d’action, le « moteur » symbolique à combustion lente nous met à l’écoute de Cio-Cio-San, incarnée de magistrale façon par la soprano Ermonela Jaho. Chaque inflexion de sa voix nous touche d’autant plus que l’expression du visage et du corps est au diapason de cette naïveté amoureuse, de ces espoirs fous et de ce désespoir profond. Il faut la voir émettre avec force et douceur, couchée sur le dos, son grand air d’espoir amoureux Un bel di, vedremo, le tube de cet opéra : bouleversant et inoubliable.
Ce n’est pas le cas de son faux « mari » américain, le ténor Adam Smith qui n’est convaincant ni dans la dégaine banale ni dans la voix, inégale. Le baryton Lionel Lhote par contre incarne avec douceur et justesse vocale le consul humaniste Sharpless.
Le bonheur de spectateur vient aussi du brillant chef d’orchestre de l’Opéra de Lyon, Daniele Rustioni qui donne à cette œuvre vériste son dramatisme et ses variations subtiles sur le thème du désespoir.
Une émotion lente se dégage de cette Butterfly sobre, une épure visuelle signée Andréa Breth, musicalement colorée par Daniele Rustioni et portée par la voix intense d’Ermonela Jaho.
Christian Jade
Madame Butterfly de Puccini au Festival d’air Aix-en-Provence jusqu’au 22 juillet ; à l’Opera de Lyon du 22 janvier au 3 février 2025. Sur Arte le 13 juillet puis sur Arte TV.
Photos © Ruth Walz