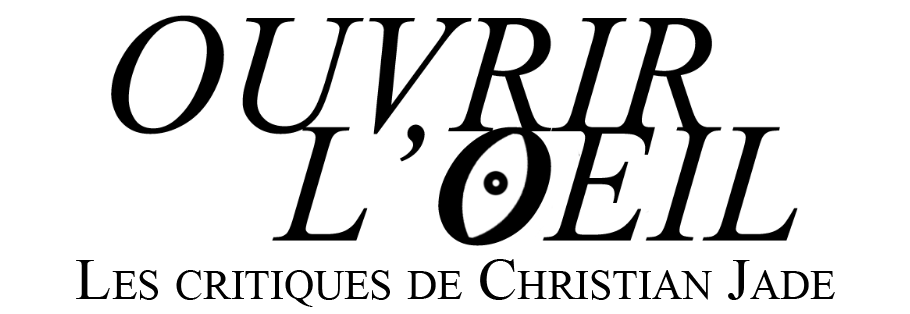« La Gioconda » de Ponchielli. Un opéra rare et virtuose. Une vision noire du pouvoir et du sexe, dans les égouts de Venise. Dur mais beau. ***
Le tandem Py/Weitz a encore frappé avec force, s’emparant de l’œuvre de Ponchielli, entre Verdi et Puccini, pour en décaper le pittoresque romantique des palais vénitiens et des ponts sur le Grand Canal. Toute l’action, oppressante, se déroule dans un immense garage envahi par une eau fétide où pataugent les protagonistes et le chœur. Le voyage dans le temps déplace aussi le décor et les costumes de l’Inquisition des Doges à des personnages plus intemporels donc aussi contemporains. Une vision radicale qui oppose l’infame manipulateur Barnaba à la généreuse Gioconda.
Dès l’ouverture, un comédien portant un masque de clown grimaçant s’installe dans une baignoire devant nous. Il ne nous quittera plus sous diverses formes, rythmant l’action et ses rebondissements comme un ange de la mort sarcastique qui grandira jusqu’à devenir au final, un masque sans corps occupant la scène. Il est comme l’ombre d’un carnaval funèbre et le fil conducteur symbolique d’une action menée par le génie du mal, Barnaba, espion de l’Inquisition et amoureux éconduit de la Gioconda. Ses multiples vengeances vont crescendo jusqu’à vouloir abuser de la Gioconda morte. L’intrigue amoureuse tourne classiquement autour de deux frustrations : Barnaba amoureux éconduit et la Gioconda, qui aime sans retour Enzo, un exilé politique. Enzo est amoureux de Laura, la femme d’Alvise, membre de l’Inquisition, un cocu qui condamne sa femme à mort. La Gioconda dans un geste héroïque (pré-féministe ?) pardonne à sa rivale, qui a sauvé sa mère, la Cieca.
Le Diable contre la Sainte ? Il y a un peu de cela, une opposition romantique entre le Bien et le Mal, héritée de Victor Hugo dont « Angelo, tyran de Padoue » a servi de modèle au librettiste Arrigo Boito. Sur ce schéma qui mêle amour et politique, dans un contexte hérité du romantisme et qui annonce esthétiquement l’opéra vériste de Puccini, Olivier Py et Pierre-André Weitz plaquent une autre vision, presque un postulat : « La beauté de Venise, affirme Olivier Py, c’est la mort, la grandeur de Venise c’est la décadence ; la puissance de Venise, c’est le mal ». Et d’y voir le crépuscule de l’Europe des lumières que nous vivons actuellement. Plus subtilement, son scénariste affirme : » Comment rendre Venise visible sans la désigner ?« . Et de créer un monde visuel sous-terrain oppressant, un trou noir, caveau, garage ou Palais enfoui, où le ciel et le soleil sont absents et où l’eau (du Grand Canal ?) suinte des murs, inondant le sol où pataugent chœur et interprètes. Comme si les créatures qui le peuplent étaient en sursis de leur mort, dans la droite logique du livret : Laura dans son catafalque, la Cieca assassinée, la Gioconda suicidée et violée. Les choristes sont revêtus de masques de clowns qui en font des figurants d’un carnaval funèbre.
Enfin, le fameux ballet « Danse des heures », qui a nourri le « Fantasia » de Walt Disney d’une adorable chorégraphie pour hippopotames et crocodiles, est remplacé par un « intermède dansé » supposé « trash » qui rend plus explicite l’érotisme décadent en mode carnaval. C’est le seul point faible de l’ensemble qui aurait requis les compétences d’un(e) vrai(e) chorégraphe plutôt que cette fantaisie un peu banale.
Pierre-André Weitz signe lui un concept très fort, noir de noir et subtil, permettant à chaque spectateur de plonger dans le gouffre intérieur des personnages et le sien propre et d’y ajouter toutes les interprétations métaphysiques et politiques qu’il veut. Il favorise aussi la concentration sur l’essentiel, la musique, somptueuse. La collaboration entre Ponchielli et Boito donne une intrigue bien construite et une partition généreuse qui ne distribue pas moins de six grands rôles parcourant tous les registres masculin (ténor, baryton, basse) et féminin (soprano, mezzo, contralto, remplacée ici par une deuxième mezzo). Les interprètes sont tous remarquables de justesse à commencer par les rôles principaux, la Gioconda de Béatrice Uria Monzon, et le Barnaba de Franco Vassallo, deux prises de rôle éclatantes de force maîtrisée. L’orchestre de la Monnaie dirigé par Paolo Carignano combine puissance et délicatesse dans le rapport aux solistes.
Au total, cette production d’une œuvre rarement jouée est un cadeau royal à ne rater sous aucun prétexte.
« La Gioconda » de Ponchielli mise en scène d’Olivier Py.
A la Monnaie jusqu’au 12 février
Cet article est également disponible sur www.rtbf.be