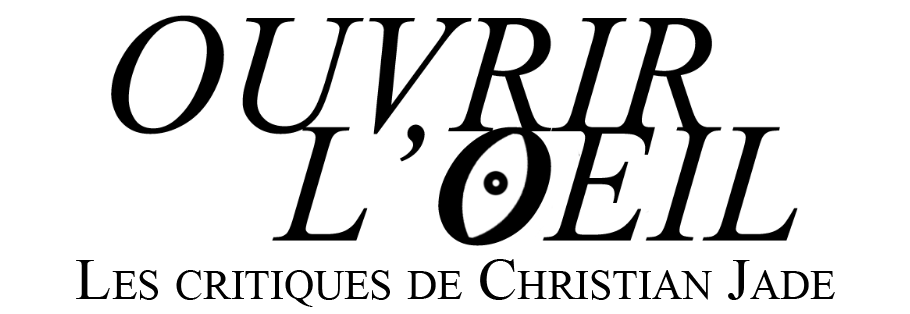« Histoire de la violence ». Comment pardonner l’impardonnable ? ****
C’est quoi une bonne pièce de théâtre ? Celle dont on sort avec plus de questions que de réponses. Or ça causait ferme au sortir de la première d’ « Histoire de la violence », une autofiction d’Edouard Louis, mise en scène par le grand Thomas Ostermeier, directeur de la Schaubühne de Berlin, sur un sujet très délicat, le viol. Hommage donc à ceux qui prennent des risques.
Critique ****
Le sujet central est hypersensible et éprouvant, un viol homosexuel narré de divers points de vue, la victime, sa famille, la police, l’auteur du viol. Ça causait donc ferme après la première : les uns craignaient que la pièce ne soit un cadeau fait aux racistes, anti-homosexuels et/ou antimusulmans. D’autres trouvaient excessif le pardon explicite et raisonné fait par la victime à son bourreau. Mais tout le monde en convenait : c’était un grand moment de théâtre.
Il y a le sujet et la manière de le traiter. Dans « Histoire de la violence », les deux sont liés, dans l’écrit comme dans l’adaptation théâtrale à laquelle Edouard Louis a contribué. Comment aller droit au but, rapporter les faits, sans tricher, et laisser la place à l’émotion, au raisonnement, à l’analyse donc à la nuance, au pardon ?
Tout commence par l’examen scientifique, en laboratoire des preuves du viol : images projetées de ces faisceaux d’indices, implacables dans leur matérialité : petits sacs d’analyses en laboratoire, empreintes numérotées, etc. Quand on découvre le narrateur, victime d’un viol portant plainte au commissariat la cause semble entendue : à part que l’interrogatoire révèle de la part des policiers un a priori « anti-maghrébin » aussitôt dénoncé par le narrateur, accusant les policiers de lui avoir imposé « leur » vision des faits.
Dans le même grand espace, apparaissent la sœur et le compagnon de sa sœur qui vont dans le même sens que la police en se défendant d’avoir des préjugés homophobes. Leur dialogue, criant de vérité, nuance la double vérité, le frère homosexuel qui se sent jugé et la sœur qui proclame son amour de la différence. Qui dit vrai, faux ? A nous, non pas de juger mais plutôt de soupeser la part de préjugés ou d’empathie/antipathie que véhicule chaque personnage.
Le sommet émotionnel vient évidemment de la reconstitution des faits par le narrateur, mais avec sa sœur et le policier brièvement présents, comme des fantômes, comme si nous assistions à « leur » version des faits, à charge : encore un doute semé sur ce que nous voyons.
Pourtant, les faits nous sont donnés avec la précision chirurgicale et visuelle d’un smartphone filmant et la nuit d’amour de ces amants de passage et la métamorphose de Reda en étrangleur, traitant son amant de « sale pédé ». Un comble de mépris de soi-même, alors qu’Edouard lui reproche simplement d’avoir volé son smartphone, pas la boîte mais son contenu. Presque en même temps, en contrechamp narratif, tout nous sera dit des circonstances atténuantes de ce Kabyle de Paris et de son cheminement social pénible. Pénible aussi l’examen médical subi par le narrateur après son viol pour lui éviter d’être, en outre, victime du sida. Le final est un plaidoyer émouvant du narrateur/victime pour la compréhension et le pardon, après toutes ces épreuves partagées par un public secoué d’avoir subi et vécu toutes ces contradictions.
Une distribution exceptionnelle, portée par l’intelligence narrative de Thomas Ostermeier.

– © Arno Declair
Voilà pour le sujet. Et la manière ? La mise en scène de Thomas Ostermeier est d’une intelligence narrative exceptionnelle : tant de situations, de points de vue sont enfilés à un rythme vertigineux, qui montre à la fois la réalité et le doute sur cette réalité. Esthétique réaliste et doute méthodique entraînent une efficacité dramaturgique totale.
A la base du succès, des interprètes exceptionnels et le support de la « caméra », un simple smartphone, (dont le vol supposé a entraîné le drame) qui projette sur grand écran des moments d’une intensité parfois insupportable. Et la batterie de Thomas Witte rythme de subtiles pulsions, sans emphase hollywoodienne, ces séquences intenses.
Dans le rôle d’Edouard Louis, (le narrateur) Laurenz Laufenberg, habité de l’intérieur et dynamique, éloquent et précis, émouvant et non dépourvu d’humour, est simplement bluffant. Mais toute la distribution a cette même présence dynamique, bien dosée, avec un coup de chapeau à Renato Schuch (Reda, l’amant violeur) et à Aline Stiegler, incarnant, entre autres, Clara, la sœur d’Edouard, traditionnelle mais pas caricaturale.
Au total un très grand moment de théâtre et des acteurs transcendants, qui nous obligent à intérioriser les contradictions des personnages et les valeurs fragiles de notre société.
« Histoire de la violence » de Thomas Ostermeier, d’après le livre éponyme d’Edouard Louis.
Au Théâtre National jusqu’au dimanche 26 janvier.
Un extrait du spectacle en V.O
Cet article est également disponible sur www.rtbf.be