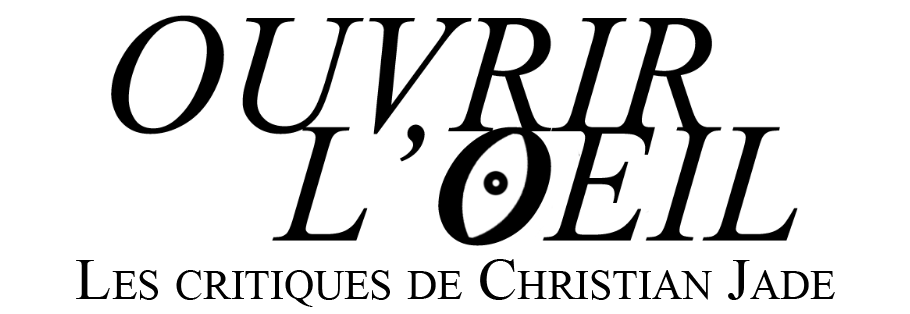« Le Roman d’Antoine Doinel ». Truffaut/Doinel/Laubin. Autoportraits en écho. Virtuose, drôle, délicieux. ***
Ça fait longtemps qu’il le porte, Antoine Laubin, son Truffaut chéri, à la fois anachronique et contemporain. Pour ceux qui, comme moi, ont connu comme un bonheur la « nouvelle vague » du cinéma français à ses débuts, Antoine Doinel, l’éternel ado incarné par Jean-Pierre Léaud, condamné à l’immaturité perpétuelle énerve et attendrit toujours. Sa version théâtrale par le duo Antoine (prédestination ?) Laubin/Thomas Depryck ressuscite le héros avec une solide dose d’humour bienvenue.
Antoine Doinel, à peine rebelle, un peu révolté, pas du tout révolutionnaire. Et pourtant avec son « roman théâtral », façon Laubin, ça boume pour lui. Le mérite du metteur en scène est d’avoir su « traduire » Truffaut, sans extraits de films anthologiques, à peine un clin d’œil ici et là, en faisant du théâtre… un cinéma, simple et efficace. Le truc « magique » de la première partie, c’est la scénographie de Prunelle Rulens et Stéphane Arcas qui par un « catwalk » plonge le spectateur au milieu d’une autoroute scénique d’où surgissent les acteurs. Le spectateur plongé au milieu du « film théâtral » est assis sur une chaise qui pivote à 360 degrés, lui permettant de « choisir son angle », transformant son œil en une caméra active et sélective. Tout au long de ces deux premières heures nous sommes donc en état d’alerte et d’éveil permanent. Le procédé permet en outre de franchir l’écueil de la chronologie puisque le même acteur, sensationnel. Adrien Drumel, est l’adolescent des « 400 coups » et l’adulte problématique des 4 autres films de référence, en fuite permanente par rapport à ses métiers et ses amoureuses successives.
La légèreté efficace du procédé scénique accompagne à merveille ce personnage un peu futile, superficiel et insupportable et, tout compte fait paradoxalement attachant à force de prouver sa faiblesse de caractère ! Un peu comme s’il incarnait, à la puissance 10, les petites lâchetés communes à l’éternelle « nature humaine ». Un prototype en somme qui nous tend un miroir, de Truffaut à Doinel/Léaud, de Doinel à Laubin et de Laubin au /à la spectateur/trice (« Masculin/Féminin » comme disait Godard, autre grand utilisateur de Jean-Pierre Léaud !). Il nous renvoie les reflets multiples et troublants de nos fragilités affectives, nos inconsistances et nos difficultés d’adaptation à la société ?
Une distribution éblouissante.

Adrien Drumel alias Antoine Doinel dans – © Beata Szparagowska
Autre force du spectacle : la solidité de la distribution et sa juste répartition par le metteur en scène. Outre Adrien Drumel, un Doinel à l’aise comme un poisson dans l’eau, Valérie Bauchau et Philippe Jeusette sont épatants de naturel, de force et de drôlerie dans le rôle des parents puis d’une série d’adultes, qu’affronte Doinel. Et les « petits rôles » épisodiques (et tellement typiques du cinéma français) sont incarnés avec conviction et distance comique par Renaud Van Camp, Jérôme Nayer et Coraline Clément Quant aux « amoureuses en souffrance », victimes de ce Casanova faiblard, elles trouvent en Caroline Berliner, Sarah Lefèvre et Adeline Vesse de touchantes incarnations.
A la reprise après une demi-heure d’entracte on retrouve toute l’équipe dans un dispositif frontal raffiné mais moins convaincant Un paradoxe puisque le thème le plus important, l’amour y trouve son plein développement. Le soudain « sérieux » du propos ralentit le rythme allègre et quasi festif de la première partie. C’est intelligent, bien fichu, fidèle à l’esprit du cinéaste mais un peu longuet par rapport à l’essentiel, déjà largement exploré. Comme si pour Truffaut le « trop plein » était l’ennemi d’un certain « vide » existentiel.
Comme si la légèreté et la virtuosité de la scénographie initiale épousait parfaitement cet être creux, irrésolu, en fuite perpétuelle : un désarroi devant la vie à la fois daté et terriblement actuel. Truffaut n’a pas la profondeur et la radicalité de Godard ni l’âpreté de Volker Schlöndorff adaptant à l’époque les « Désarrois de l’élève Törless » de Musil. Faut pas demander à un Français de parler allemand ou suisse. Mais Truffaut/Laubin c’est tellement « français », dans la lignée de Stendhal, Musset ou Marivaux qu’on s’incline : ce bouquet sentimental, porté par des acteurs splendides est, en somme, irrésistible. A voir d’urgence.
Le Roman d’Antoine Doinel d’Antoine Laubin et Thomas Depryck au Théâtre Varia jusqu’au 12 octobre.
Cet article est également disponible sur www.rtbf.be